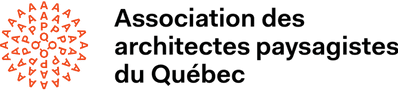Définition des phytotechnologies ?
Les différents termes utilisés
Phytotechnologie
Les phytotechnologies sont des technologies bâties par l’intervention humaine qui utilisent les plantes vivantes pour optimiser la livraison de divers services écosystémiques. Elles sont utilisées pour offrir des services comme épurer l’eau, l’air, le sol, contrôler l’érosion et le ruissellement, restaurer des sites dégradés, séquestrer des gaz à effet de serre ainsi que réduire la chaleur et la vitesse des vents. Dans les phytotechnologies, les plantes et leurs alliés fongiques ou bactériens travaillent en synergie. Les phytotechnologies incluent les marais filtrants, les toitures et murs végétalisés, les haies brise-vent, les barrières sonores végétales, les systèmes végétalisés de gestion des eaux pluviales (systèmes de biorétention, jardins de pluie, etc.), les bandes riveraines ou autres structures de stabilisation des pentes végétalisées ainsi que de simples arbres de rue.
Infrastructure naturelle
Les infrastructures naturelles sont généralement définies comme un ensemble d’espaces naturels verts et bleus interreliés permettant de préserver la valeur et les fonctions des écosystèmes qui fournissent des bénéfices aux sociétés humaines. Il s’agit « d’un réseau interconnecté d’aires naturelles et autres espaces ouverts conservant les valeurs et les fonctions écosystémiques, aidant à purifier l’air et l’eau et donnant un vaste champ de bénéfices à la population, à la faune et la flore ». Ainsi, les infrastructures naturelles regroupent les milieux naturels et humanisés qui constituent une trame verte et bleue, tels les parcs urbains, les boisés, les milieux humides, les plans d’eau et les bandes riveraines, les friches, les arbres, les platebandes, les sols, etc. Ces composantes de l’environnement fournissent des services écologiques qui sont essentiels au maintien de la santé et à la qualité de vie des citoyens.
Génie végétal
En France, on utilise souvent le terme génie végétal ou ingénierie végétale pour désigner les phytotechnologies. Au Québec, la Loi sur les ingénieurs prévient l’emploi de termes descriptifs comprenant le mot « ingénieurs » que si le porteur est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ainsi donc, le terme phytotechnologies qui n’est soumis à aucune obligation légale, mais qui est scientifiquement précis, est majoritairement utilisé au Québec. Le génie végétal, parfois plus largement désigné comme le génie biologique, désigne l’utilisation des techniques utilisant les végétaux ayant des propriétés mécaniques ou biologiques favorables au contrôle, à la stabilisation ou à la gestion des sols érodés. Le terme génie fait spontanément penser aux techniques comme les plançons (lits de plants disposés le long des courbes de niveau), aux fascines (assemblage de tiges liées en paquets ancrées par des pieux), aux tressage (branches vivantes entrelacées) ou aux caissons végétalisés (rondins de bois remplis de terre où s’ancrent des boutures consolidant la structure qui soutient des sols en pente). Mais en France, on utilise aussi ce terme pour la restauration, la réhabilitation ou la renaturalisation de milieux dégradés, misant en particulier sur l’aménagement paysager; et aussi la phytoréhabilitation ou phytoremédiation permettant d’épurer ou de décontaminer des sols et des eaux. L’ingénierie végétale désigne la conception des projets d’application du génie végétal ou génie biologique.
Les types de phytotechnologies

Les marais filtrants sont des écosystèmes recréés artificiellement afin de traiter une large gamme d’eaux usées, dont des effluents municipaux, industriels et agricoles.
L’épuration des eaux usées en marais filtrants se fait selon une combinaison de processus physiques, chimiques et biologiques. Les plantes jouent un rôle essentiel en marais filtrant, notamment en favorisant le développement des microorganismes et en oxygénant le milieu. Comparativement aux systèmes conventionnels de traitement des eaux usées, les marais filtrants ont un faible coût d’installation et d’exploitation et ne nécessitent aucun produit chimique et peu ou pas d’énergie. De plus, ils offrent un habitat pour la faune et bénéficient d’une grande acceptabilité sociale.
Les marais filtrants peuvent servir à traiter une large gamme d’eau contaminées telles que les eaux usées municipales, les effluents miniers, les effluents industriels contenant des contaminants organiques ou inorganiques, les effluents agricoles et bien plus encore. Par exemple, pour l’épuration des lacs, des systèmes de marais flottants ont été mis en place afin d’utiliser les végétaux pour enlever le surplus de nutriments. Une variation des marais filtrants conventionnels sont les lits de séchage de boue qui ont pour objectif de stabiliser la matière organique par minéralisation grâce aux bactéries, de réduire le volume de boue à traiter et à transporter grâce à l’évapotranspiration des plantes et à l’effet de la gravité. En plus d’améliorer la déshydratation de la boue, la présence des végétaux favorise le développement de macroorganismes et de microorganismes, recréant ainsi un écosystème.
Avantages
• Retenir, enlever et dégrader les polluants
• Réduire le volume d’eau ou de boue par évapotranspiration
Limites
• Grandes surfaces requises
• Moins efficaces en hiver.
Fiche technique SQP marais filtrant
Gagnon, V., Brisson, J. Les marais filtrants (eaux usées). 2013. Fiche. Société Québécoise de phytotechnologie.
https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/02/SQP_Fiche_MaraisFiltrants.pdf
Fiche technique SQP lit de séchage de boue
Vincent, J., Brisson, J. Les lits de séchage plantés de macrophytes. 2014. Fiche. Société Québécoise de phytotechnologie.

Tout type de toiture recouverte de végétaux est une toiture végétalisée, aussi appelée toit vert. Ils peuvent être de type extensif, intensif ou semi-intensif.
Type extensif
Le toit végétalisé extensif se distingue par sa légèreté (mince couche de substrat variant de 5 à 15 cm d’épaisseur), son coût relativement faible et une sélection d’espèces végétales limitées, tel que des crassulacées, de bryophytes et à certaines herbacées. Il convient de noter que, bien que ce type de système comporte de faibles charges et puisse généralement être installé sur une structure existante, une profondeur de 5 cm n’est pas adéquate sous nos latitudes pour la survie à long terme des végétaux. Il est recommandé d’opter pour un système comportant minimalement 10 cm de substrat. Le toit végétalisé extensif, principalement à cause de sa faible épaisseur de substrat, ne permet pas d’optimiser bon nombre de fonctions recherchées. À titre d’exemple, il présente une capacité de rétention réduite des eaux pluviales, conséquemment il importe de sélectionner des végétaux résistants à la sècheresse. Étant beaucoup plus léger, ce type se prête autant à l’aménagement des toitures de grands édifices commerciaux et institutionnels qu’aux toitures d'immeubles d’habitation ayant été renforcées.
Type intensif
Le toit végétalisé intensif est constitué d’une épaisseur de substrat plus profonde (couche de substrat excédant 30 cm d’épaisseur) ce qui permet l’utilisation d’une plus grande diversité de plantes. L’augmentation de l’épaisseur du substrat permet l’établissement d’une végétation plus diversifiée et maximise le développement de milieux de vie pour les plantes et les animaux. Le poids de ce type de système doit être envisagé en fonction de la capacité portante du toit. Le toit végétalisé de type intensif peut nécessiter ou non un système d’irrigation. Ce type de toit végétalisé permet d’optimiser la majorité des fonctions recherchées. Généralement accessible aux usagers, il permet d’augmenter les superficies récréatives et utilitaires.
Type semi-intensif
Le toit végétalisé de type semi-intensif est un type intermédiaire dont la profondeur du substrat de croissance se situe entre 15 et 30 cm. Ce type est généralement doté d’un système d’irrigation permettant l’implantation d’une gamme plus variée de végétaux. Selon la capacité portante de la structure, ce type de toit végétalisé peut être accessible aux usagers.
Les types intensifs et semi-intensifs peuvent également être composés de bacs de culture étanches.
Avantages
• Contrer les îlots de chaleur urbains
• Participer à la régulation thermique du bâtiment (isolation)
• Ralentir et diminuer le ruissellement et le rejet d’eau de pluie à l’égout (gestion des eaux pluviales)
• Améliorer l’aspect esthétique des toitures (contribution à la qualité du paysage)
• Augmenter les superficies récréatives et productives
• Favoriser la biodiversité (création d’habitats pour la faune et la flore)
• Améliorer la qualité de l’air extérieur (poussières, CO2, O2)
Limites
• Posséder un toit dont la capacité portante peut soutenir le poids de la toiture végétalisée
• Respecter la règlementation
• Obtentir le permis requis
• Entretenu régulièrement
Références :
Critère technique visant la construction de toits végétalisés
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-criteres-techniques-construction-toits-vegetalises.pdf
La construction de toits végétalisés : guide technique pour une solution de rechange
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/TOITSVEGETALISES_CAHIEREXPLICATIF_JANVIER2014.PDF
Gaudry, É.,Lacombe, S., Dupras, I., Gobeille, L., Rousseau, M., Vallée, C. Les toits végétalisés. 2015. Fiche. Société Québécoise de phytotechnologie. https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/02/SQP_Fiche_Toits-v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9s-2.pdf

Murs couverts de végétaux pouvant être composés de plantes grimpantes ou de végétaux enracinés dans un support muni d’un système d’irrigation intégré.
À leur plus simple expression, les murs végétalisés sont des murs classiques recouverts de plantes grimpantes. Les murs végétalisés plus technologiques permettent l’enracinement directement sur la structure verticale dans des caissettes, des panneaux modulaires ou du géotextile.
Les végétaux permettent la régulation thermique des bâtiments : l’ombrage et évapotranspiration rafraîchissent en été tandis que les végétaux atténuent le refroidissement éolien en hiver. Comme tous les végétaux, les plantes qui composent les murs végétalisés peuvent fournir de l’oxygène et fixer le dioxyde de carbone. Certains systèmes intérieurs sont par ailleurs conçus pour épurer l’air des bâtiments (les bactéries vivant dans la rhizosphère peuvent par exemple dégrader les composés organiques volatils). Les murs végétalisés plus technologiques demandent une irrigation et une fertilisation régulière.
Avantages
• Régulation thermique des bâtiments
• Atténuation de la vélocité du vent et de son effet refroidissant l’hiver
• Captation de l’eau de pluie
• Réduction de la vitesse de ruissellement
Limites
• Les murs technologiques demandent un entretien régulier
• Les plantes grimpantes peuvent endommager les murs déjà fissurés ou cacher les fissures préexistantes
Références :
Murs végétalisés – Le Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec
http://www.iqdho.com/images/stories/projets/Murs%20vegetaux_15oct.pdf
Mur végétal
http://ligneverte.net/nosservices/mur-vegetal/
Nedlaw living walls – Only living wall biofilters improve indoor air quality.
http://www.nedlawlivingwalls.com/

Les haies brise-vent sont des aménagements végétalisés linéaires qui permettent de réduire la vitesse du vent.
Ils servent à contrer l’érosion et l’assèchement du sol, favoriser l’accumulation de neige au sol limitant l’érosion éolienne hivernale sur les sols dénudés, de réduire la dispersion des odeurs et d’offrir un refuge à la biodiversité (i.e. pollinisateurs). L’orientation des haies brise-vent par rapport aux vents dominants, leur hauteur ainsi que leur porosité détermineront leur efficacité. Les haies brise-vent peuvent servir d’écrans visuels et limiter la dispersion des poussières près de carrières, par exemples, ou aider à favoriser la santé des sols et la productivité en milieu agricole.
Avantages
• Contrer l’érosion et l’assèchement des sols provoqués par le vent l’été
• Diminuer la vélocité des rafales de neige et de vent l’hiver en contrôlant l’accumulation de neige
• Réduire les odeurs ou favoriser la pollinisation.
Limites
• Créer de l’ombre aux cultures, ce qui diminue leur productivité.

Structure végétale verticale composée de matériaux de remplissage et de végétaux qui ont une fonction acoustique et esthétique.
Les murs antibruit végétaux permettent de réduire la pollution sonore, au bénéfice des résidents qui habitent par exemple le long d’infrastructures routières ou industrielles. Leur aspect visuel s’harmonise avec l’environnement et jouit d’une acceptabilité sociale accrue comparée aux murs de béton. Les palissades faites de tiges de végétaux comme le bambou ou le saule peuvent casser partiellement le bruit, et en présence de végétaux vivants, le vent bruissant dans les feuilles peut diminuer notre perception d’un autre bruit environnant. Mais même une haie densément plantée ou de 3 mètres d’épaisseur ne peut à elle seule résoudre un problème de bruit important. Cependant, les haies végétales peuvent limiter la propagation du bruit en réduisant par exemple le vent qui porte les sons. En offrant un écran visuel, les végétaux peuvent aussi contribuer à une impression d’isolement et donc de ressenti à l’égard des bruits. Pour avoir une solution véritablement efficace contre les bruits, c’est-à-dire réduire les décibels dans un endroit donné, les murs doivent réfléchir ou absorber le bruit.
Les écrans acoustiques doivent comporter d’une part un matériau absorbant, comme de la laine de roche acoustique qui offre une bonne performance avec une faible épaisseur. Certains murs acoustiques ont aussi misé sur une certaine épaisseur de terre. Un cadre structurel en bois, doublé de parois en géotextile peut être utilisée. Mais l’empreinte au sol de ces structures peut être importante, et avec le temps, la terre finit par se tasser et donc par laisser passer les bruits, à moins d’un entretien régulier. Ces écrans acoustiques gagnent en esthétisme s’ils comportent des plantes vivantes au sein de leur structure : au fil des saisons, le feuillage et les tiges des végétaux peuvent fluctuer, donnant une impression vivante plutôt que statique au mur.
Le saule est souvent utilisé au Canada dans les parois végétales anti bruit. Sur le bord des autoroutes, comme l’autoroute des Laurentides, on a vu des murs vivants, dont le saule porte des feuilles vertes en été, jaunes en automne puis laisse paraître des tiges nues en hiver. Cependant, dépendamment de l’orientation du soleil ou de la dispersion du sel de déglaçage, ce genre de mur peut se dégarnir par endroits et nécessiter un remplacement de tiges. D’autres formes de murs utilisent maintenant un cœur en panneau acoustique, bordé de tiges de saules non vivants, avec ou sans écorce. Ces structures sont plus performantes avec une empreinte au sol réduite, mais leur coût est plus élevé. Leur durée de vie serait d’environ 25 ans en Europe, des structures similaires au Québec auraient déjà été installées il y a 15 ans. Sur n’importe quel type de structure coupe-son, y compris celles en tiges de saules, des plantes grimpantes comme les vignes de rivage peuvent donner un visuel intéressant à la structure.
Outre l’absorption du son, il est estimé qu’un kilomètre de mur coupe-son végétal en saule vivant pourrait capter jusqu’à 6,8 tonnes de CO2 par année. Son implantation coûterait entre 400$ et 600$ le mètre linéaire selon le type de sol, le type de structure portante et la hauteur des tiges à l’implantation.
Avantages :
• Harmonie avec le paysage
• Acceptabilité sociale accrue
• Verdissement rapide
• Apparence saisonnière variable
• Durée de vie de 20-30 ans
• Captation des poussières et des gaz à effet de serre provenant des routes
• Efficace comme brise-vent
• Habitat propice à la faune aviaire
• Implantation rapide et simple
Limites :
• Végétaux vivants nécessitant des conditions optimales de croissance • Entretien requis • Occupation plus importante de l'espace que des parois non vivantes
Références :
http://www.lesecransverts.ca/project/amt-ville-saint-laurent/
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0962930/04_Agro_Energie.pdf
http://www.monjardinmamaison.fr/mon-jardin-ma-maison/courrier-des-lecteurs/quelles-sont-les-especes-vegetales-qui-isolent-du-bruit-63387.html
http://www.envirosaule.com/utilisations.html
http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/realisation-dun-mur-fait-de-vegetaux.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide_particuliers_realiser_mur_antibruit.pdf

Ce sont des systèmes ayant pour fonction de filtrer, retenir, ralentir, infiltrer et évaporer l’eau de pluie et l’eau de ruissellement.
On peut séparer les systèmes de gestions des eaux pluviales en plusieurs catégories en fonction de leurs fonctions : les ouvrages de rétention, d’infiltration, de transport et d’évapotranspiration des eaux pluviales.
Les ouvrages de rétentions sont destinés à recueillir les eaux pluviales afin de retarder leur arrivée dans le réseau d’égout pluvial ou non. Ils ont comme fonction de réduire le volume et le débit de pointe des eaux de ruissellement et ainsi de diminuer la fréquence des épisodes de surverses et la pollution des cours d’eau récepteurs. Ils peuvent être appelés bassin de rétention végétalisé ou zone de biorétention. Les ouvrages d’infiltration, tels que les jardins de pluie, permettent de récolter l’eau de ruissellement, d’en retenir une partie et de favoriser son infiltration dans le sol. Cette eau peut être apportée par une gouttière ou une autre forme de canalisation permettant de recueillir les eaux provenant d'une surface collectrice (terrasse, toiture), ou tout simplement les eaux se rendent naturellement au point le plus bas où se trouve le jardin de pluie. Les ouvrages de transport permettent d’acheminer graduellement et lentement une partie de l’eau de ruissellement vers le réseau collecteur. Ils permettent également une certaine infiltration dans le sol. Les ouvrages d’évapotranspiration vont permettre de récolter l’eau de ruissellement et de favoriser son absorption par les végétaux et sa transpiration par le feuillage de ces dernières.
Avantages
• Permet la rétention, l’infiltration, le transport, l’évapotranspiration et la filtration de l’eau de pluie
• Permet de désengorger les systèmes d’égouts combinés où l’eau de pluie et les eaux usées sont traitées au même endroit.
Limites
• Débits d’entrée irrégulier pouvant causer un stress hydrique chez les plantes
• Nécessite des plantes capables de tolérer à la fois des conditions de sècheresse et d’inondation.
Références
I. Séguin Aubé, R. Leblond, É. Prido, D. Dagenais. Les biorétentions. 2017. Fiche. Société Québécoise de phytotechnologie. https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/04/Fiche-bior%C3%A9tention-finale_LHEb-ilovepdf-compressed.pdf Dagenais, D., Paquette, S., Thomas, I., & Fuamba, M. (2014). Implantation en milieu urbain de systèmes végétalisés de contrôle à la source des eaux pluviales dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques : balisage des pratiques québécoises, canadiennes et internationales et développement d’un cadre d’implantation pour les municipalités du Sud du Québec.
http://www.imaginonsnotredelson.ca/wp-content/uploads/2016/01/Dagenais_systemes_vegetalises_2014.pdf
Rivard, G., MDELCC, & MAMROT. (2011). Guide de gestion des eaux pluviales stratégies d’aménagement, principes de conception et pratiques de gestion optimales pour les réseaux de drainage en milieu urbain. Québec: Gouvernement du Québec.
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2020783
MAMROT. (2010). Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable - La gestion durable des eaux de pluie - guide_gestion_eaux_pluie_partie_2.pdf.
http://www.mamot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_ partie_2.pdf
MDDELCC.(2017). Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/pluviales/manuel-calcul-conception/manuel.pdf

Les bandes riveraines
Les bandes riveraines sont des aménagements végétalisés à l’interface entre les écosystèmes terrestres (champs, forêts, résidences, etc.) et aquatiques (fossés, ruisseaux, lacs, etc.).
Elles peuvent être composées de végétaux homogènes ou mixtes, tels des herbacées, des arbustes et des arbres. Elles peuvent remplir plusieurs rôles comme la prévention de la pollution aquatique de source diffuse (limiter le ruissellement de surface, empêcher le transfert des particules de terre érodée, des fertilisants ou des pesticides). On leur attribue aussi une fonction paysagère et d’habitat pour la biodiversité. Lorsque des arbres poussent en bordure des cours d’eau, ils peuvent par ailleurs prévenir le réchauffement excessif des eaux de surface, fournir des matières organiques qui alimentent l’écosystème aquatique ou être source de bois mort complexifiant l’écosystème et contribuant à la régulation hydrique.
Si la bande riveraine prévient la migration vers les cours d’eau des matières organiques terrigènes érodées ou lessivées par la pluie ou la fonte des neiges, les contaminants dissouts ou adsorbés aux particules (comme les pesticides) peuvent y être retenus (phytoextraction des métaux lourds) ou décomposés (phytoremédiation des pesticides ou fertilisants). Les bandes riveraines peuvent aussi protéger les rives contre l’érosion, comme dans les autres ouvrages phytotechnologiques de stabilisation du sol ou des pentes.
Avantages
• Diminue l’érosion des rives
• Diminue l’accumulation de particules lessivées
• Augmente la biodiversité locale
Limites
• Efficacité de filtration des nutriments ou des pesticides variable
• Perte d'efficacité lorsque la bande riveraine est discontinue
• Perte d'espace sur des terres agricoles (empreinte au sol importante)
Références :
Hénault-Ethier et al. 2014. Les bandes riveraines en agriculture Une approche pluridisciplinaire pour une application concrète. Article technique. Vecteur Environnement. Septembre : 52-57.
https://www.researchgate.net/profile/Louise_Henault-Ethier2/publication/282367083_Les_bandes_riveraines_en_agriculture_-_Une_approche_pluridisciplinaire_pour_une_application_concrete/links/5612ac3c08ae4f0b65159729.pdf
Hénault-Ethier, L. (2016). Usage de bandes riveraines composées d'herbacées ou de saules arbustifs pour limiter les flux agro-chimiques des grandes cultures vers les cours d'eau et produire de la biomasse dans la plaine agricole du Saint-Laurent (Doctoral dissertation, Université du Québec à Montréal).
http://www.archipel.uqam.ca/8821/1/D3112.pdf

Stabilisation du sol ou des pentes :
Utilisation de plantes vivantes pour maintenir le sol en place et en réduire l’érosion.
Habituellement utilisées pour la fixation des sols de talus ou de rives. Les techniques utilisées peuvent être entièrement végétales ou mixtes, utilisant également des éléments minéraux tels que les ouvrages d'enrochement (blocs de pierre et les gabions…) pour fixer les sols aux prises avec d’importants problèmes d’érosion.
Avantages
• Permet de maintenir le sol en place
• Éviter l’érosion de façon naturelle et durable.
Limites
• Les pentes très fortes peuvent difficilement être maintenue par la présence seule de végétaux.
Références :
Rousseau, Michel. 2010. La stabilisation des sols et les phytotechnologies. Formation continue de l’AAPQ. 44p. https://aapq.org/sites/aapq.org/files/bibliotheque/FC_GRL_27-11-2010.pdf
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs. 2005.
Techniques de stabilisation des rives. Chapitre 7 extrait du Guide des bonnes pratiques, Protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/stabilisation_rives.pdf

Visibles à travers les villes, on ignore souvent que les arbres de rue sont des phytotechnologies.
Il existe une étroite relation entre la santé des citoyens et la forêt urbaine. Les arbres de rue, composantes importantes de la canopée urbaine, avec les forêts urbaines, offrent une multitude de services aux citoyens, améliorant du même coup leur santé et celle de l’environnement. Ensemble, ils peuvent contribuer à atténuer l’impact des changements climatiques sur les humains. Ils peuvent notamment lutter contre la pollution de l’air, contre les épisodes de smog, et lutter contre les îlots de chaleur urbains.
Les infrastructures vertes, comme les arbres de rue, sont le seul type d’infrastructure qui prend de la valeur avec le temps, à cause de leur croissance. Mais aux stress existants pour les arbres en milieu urbain (faible infiltration des précipitations dans le sol, manque d’espace aérien et souterrain, sels de déglaçage, sol compacté, impacts de machinerie, infrastructures aériennes et souterraines nécessitant l’élagage des arbres ou le creusage périodique dans la zone racinaire, etc.), s’ajoute l’effet des changements climatiques (chaleur, sécheresse, invasions d’insectes). Dans le milieu urbain, le paysagement a historiquement favorisé des peuplements homogènes, pour unifier le paysage à l’échelle des rues et des quartiers. Cette situation fragilise l’équilibre de la canopée urbaine en cas d’invasion d’insectes favorisés par les changements climatiques ou dans le cas d’arrivée de nouvelles espèces exotiques envahissantes pour lesquels il n’y a que peu de prédateurs naturels.
Ainsi, l’arrivée de l’agrile du frêne en Amérique du Nord, la mortalité des frênes aurait non seulement dégarni le paysage, mais aussi eu des répercussions sur la santé des citadins. En seulement six ans, 21 000 décès supplémentaires auraient été attribués aux maladies cardio-vasculaires et respiratoires dans 15 états américains touchés (Donovan et al. 2013). Sans intervention, l’espérance de vie des arbres atteint est inférieure à six ans, et le ralentissement de la progression de l’envahisseur pour retarder l’abattage est souhaitable, mais coûteux.
Avantages
• Permet l’infiltration et l’évapotranspiration de l’eau de pluie
• Embellit les rues
• Atténue l'effet des îlots de chaleur
• Séquestre les gaz à effet de serre
• Diminue la quantité de poussières
Limites
• Mortalité élevée pendant les premières années si l' arbre est négligé
• Sensibilité aux maladies dans les quartiers à faible biodiversité.
Références :
Paquette, Alain et Christian Messier. 2016. Pour une plantation qui augmente la résilience des arbres municipaux de Gatineau. Chaire de recherche CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres. Rapport final. 42p.
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportMessier2016.pdf
Repenser le reboisement – Guide stratégique pour l’augmentation de la canopée et de la résilience de la forêt urbaine de la région métropolitaine de Montréal. Chaire de recherche CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres.
http://www.arbresurbains.uqam.ca/fr/guidereboisement/guide.php
Paquette, Alain. Repenser le reboisement – Guide stratégique pour l’augmentation de la canopée et de la résilience de la forêt urbaine de la région métropolitaine de Montréal. Jour de la terre Québec. 29p.
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les- jours/programmes/repenser-le- reboisement/telechargez-le- guide/
Donovan, Geoffrey H., et al. 2013. The Relationship Between Trees and Human Health – Evidence from the Spread of the Emerald Ash Borer. American Journal of Preventive Medicine. Vol 44 (2) 139-145.
http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(12)00804- 5/abstract
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130116163823.htm

La phytoremédiation utilise des plantes et des microorganismes qui leur sont associés pour nettoyer l’environnement.
En fait, c’est un ensemble de techniques in situ (pouvant être implantées directement sur le site contaminé) misant sur les plantes pour extraire, dégrader ou immobiliser les contaminants dans les sols, les sédiments, les boues ainsi que dans l’eau de surface ou souterraine et dans l’air. Plus de détails sur les processus sous-jacents à la phytoremédiation sont détaillés plus bas. La phytoremédiation est aussi décrite comme une stratégie économique et efficace d’éco-remédiation fonctionnant à l’énergie solaire.
Les méthodes biologiques comme la phytoremédiation (à l’aide de plantes), la bioremédiation (à l’aide de microorganismes) ou la mycoremédiation (à l’aide de champignons) peuvent être complémentaires aux méthodes non-biologiques comme l’excavation. Par exemple, la décontamination peut miser sur l’excavation des portions de terre plus contaminées et la phytoremédiation afin de poursuivre le travail.
Avantages
• Économique
• In situ
• Versatile
• Socialement acceptable
• Durable
• Services écosystémiques
• Enrichissement de la biodiversité
• Conservation de la structure et des propriétés des sols
• Meilleure esthétique visuelle des sites
Limites
• Travaux à long terme
• Inapproprié aux fortes contaminations
• Contact nécessaire avec les racines
• Nécessité de biodisponibilité des contaminants
• Besoin d’espace
• Risque de contamination de la chaîne alimentaire
• Efficacité variable
• Défis réglementaires
En fonction du type de polluant (organique ou inorganique) et du milieu contaminé (sol, eau, etc.), la phytoremédiation repose sur divers principes (Voir les informations supplémentaires ci-bas). Références :
Hénault-Ethier, L. La Phytoremédiation. 2016. Fiche. Société Québécoise de phytotechnologie.
https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/04/fiches-Phytoremediation.pdf
https://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/02/SQP_Fiche_Lits-de-s%C3%A9chage.pdf
Labrecque, M.; Pitre, F., Choisir la phytoremédiation. Une alternative végétale durable pour la décontamination des sols. Fiche technique produite pour le compte du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Projet 11-12-PSVT2-21940. Institut de Recherche en Biologie Végétale, Ed. 2014; p 2 EPA, U., Phytoremediation Resources Guide. Government of the Unites States of America: Washington, USA, 1999; p 56.
Phytoremédiation
Processus sous-jacents

Dans la phytoextraction, aussi appellée phytoaccumulation, les plantes retirent du sol les contaminants, comme les éléments traces métalliques et métalloïdes biodisponibles, ainsi que certains types de contaminants organiques, et les accumulent dans leurs parties aériennes que l’on peut par la suite récolter. C’est la méthode de phytoremédiation la plus utilisée pour les contaminants inorganiques (métaux et métalloïdes).

Dans la phytostabilisation, les plantes réduisent la mobilité et la biodisponibilité des contaminants dans le sol ou la rhizosphère, par immobilisation chimique (précipitation, stabilisation, absorption ou piégeage) ou par prévention des mouvements latéraux ou en profondeur via l’érosion ou le lessivage. La phytostabilisation empêche ainsi la dispersion des contaminants dans les eaux de surface et souterraines.

Dans la phytodégradation, aussi appellée phytotransformation, les plantes absorbent et dégradent les polluants organiques dans leurs tissus ou sécrètent des enzymes liées à la dégradation dans la rhizosphère. On la distingue de la rhizodégradation, aussi appelée phytostimulation, dans laquelle la décontamination s’opère dans le sol. Dans la rhizodégradation, la décontamination est effectuée dans la rhizosphère par les micro-organismes dont la croissance et l’activité sont stimulées par les plantes. Malgré cette distinction théorique, la dégradation dans l’un ou l’autre des deux compartiments est souvent difficile à circonscrire précisément.

Dans la phytovolatilisation, des polluants organiques et certains composés inorganiques sont extraits du sol par les plantes, transportés dans leur système vasculaire, puis relargués dans l’atmosphère par transpiration (Figure 5). C’est une technologie attrayante parce que les polluants sont ainsi entièrement volatilisés (sous forme de gaz), et il n’est donc pas nécessaire de récolter et de traiter les plantes utilisées. Par contre, le risque du transfert des polluants vers l’atmosphère doit être bien caractérisé avant d’entreprendre de la phytovolatilisation. En milieu riverain ou pour la rhizofiltration (voir définition plus bas) d’effluents contaminés, on capitalise entre autres sur le fort potentiel d’évapotranspiration de certains végétaux pour freiner le ruissellement de l’eau ou sa diffusion dans le sol.

Avec la rhizofiltration, on peut traiter des eaux usées municipales ou industrielles, le ruissellement de surface ou l’eau qui s’infiltre dans le sol en zone agricole, le lixiviat des mines et des sites d’enfouissement, ou encore la contamination de l’eau souterraine. Les contaminants visés incluent les éléments-traces métalliques, les radionucléides, le sélénium, les nutriments, certains composés organiques comme les pesticides, ou encore le drainage minier acide. La rhizofiltration peut utiliser des plantes aquatiques ou des plantes terrestres, et parfois une combinaison d’espèces ayant des propriétés complémentaires.