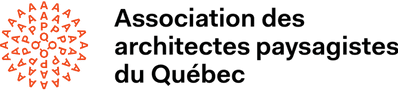Fiches techniques
Au travers d'échanges avec plusieurs spécialistes du domaine des phytotechnologies, la SQP mets sur pied chaque année une ou des fiches techniques. Celles-ci ont comme objectif de faire découvrir plus en profondeur différentes phytotechnologies ou un aspect plus particulier de ces dernières. Ces fiches offrent des éléments pertinents pour les praticiens municipaux, en planification urbaine, en aménagement paysager désireux d’intégrer ces technologies à leurs projets. Les fiches recensent l’historique, les objectifs, les services écosystémiques, le fonctionnement, les végétaux, les avantages et limites pertinents à chaque phytotechnologie. Une revue de quelques projets récents implantés au Québec ou ailleurs dans le monde est aussi proposée à titre d’exemple.

Les marais filtrants (2025)
Résumé : La présente fiche technique traite des grandes généralités entourant le fonctionnement types de marais filtrants les plus communément utilisés. L’usage de marais filtrants pour le traitement des eaux usées peut représenter une alternative intéressante dans de nombreuses situations, puisqu'ils sont peu énergivores, peu coûteux au niveau de l’opération et de l’entretien, demandent peu d’expertise pour la maintenance, tolèrent des débits élevés, peuvent être construits avec des matériaux locaux, en plus d’être particulièrement bien adaptés aux secteurs décentralisés.Visionner la capsule vidéo sur les marais filtrants ici.
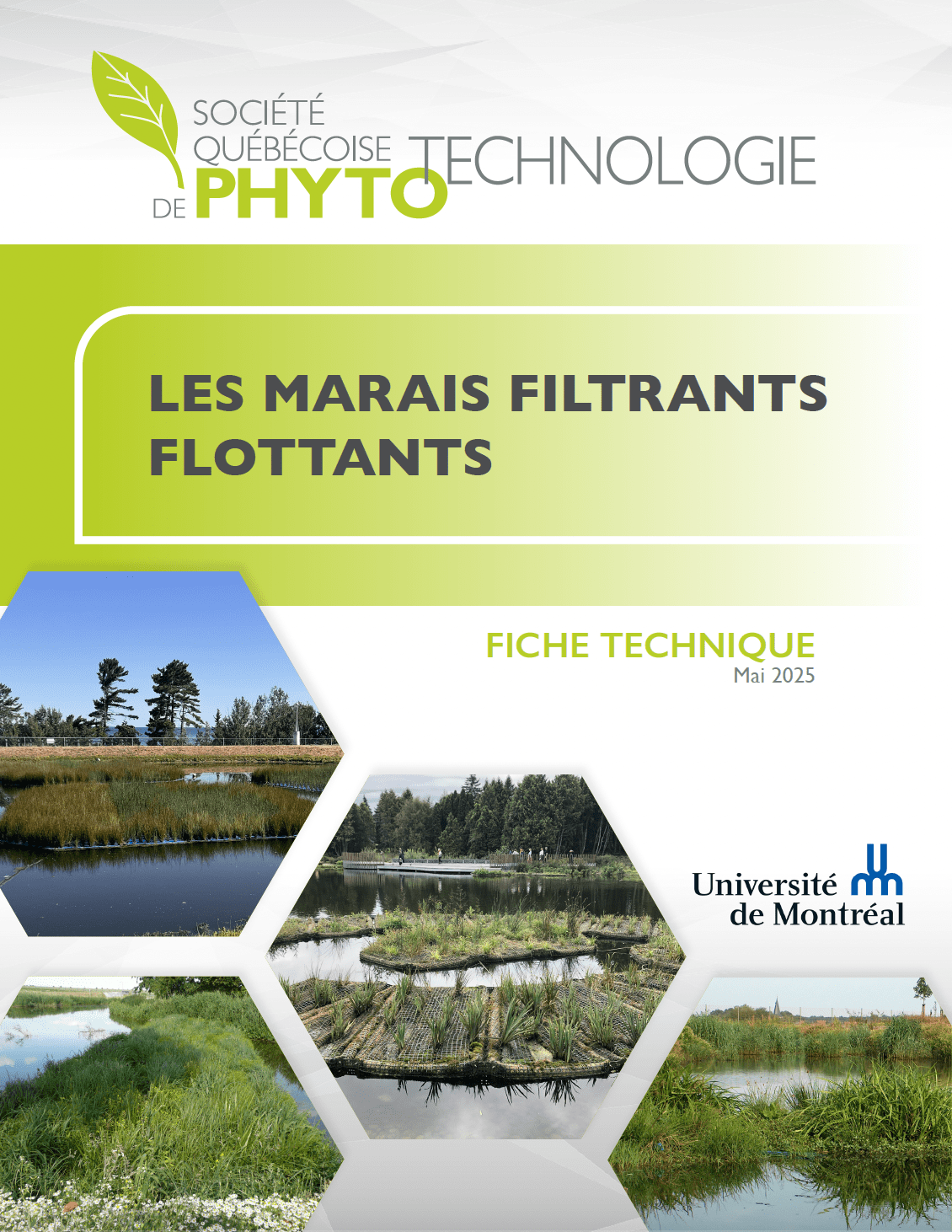
Les marais filtrants flottants (2025)
Résumé : L’usage des marais filtrants flottants pour améliorer la qualité de l’eau est désormais répandu à travers le monde. Similairement aux autres types de marais filtrants, ces îles flottantes végétalisées offrent une alternative durable pour le traitement de divers types d’eaux usées. Cette phytotechnologie se distingue toutefois par sa flottabilité, lui permettant de traiter divers plans d’eau sans perturber le site d’implantation et en s’adaptant à de grandes fluctuations de débit.Visionner la capsule vidéo sur les marais filtrants flottants ici.
Auteurs : Laurianne Bédard et Jacques Brisson
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
Auteurs : Laurianne Bédard et Jacques Brisson
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
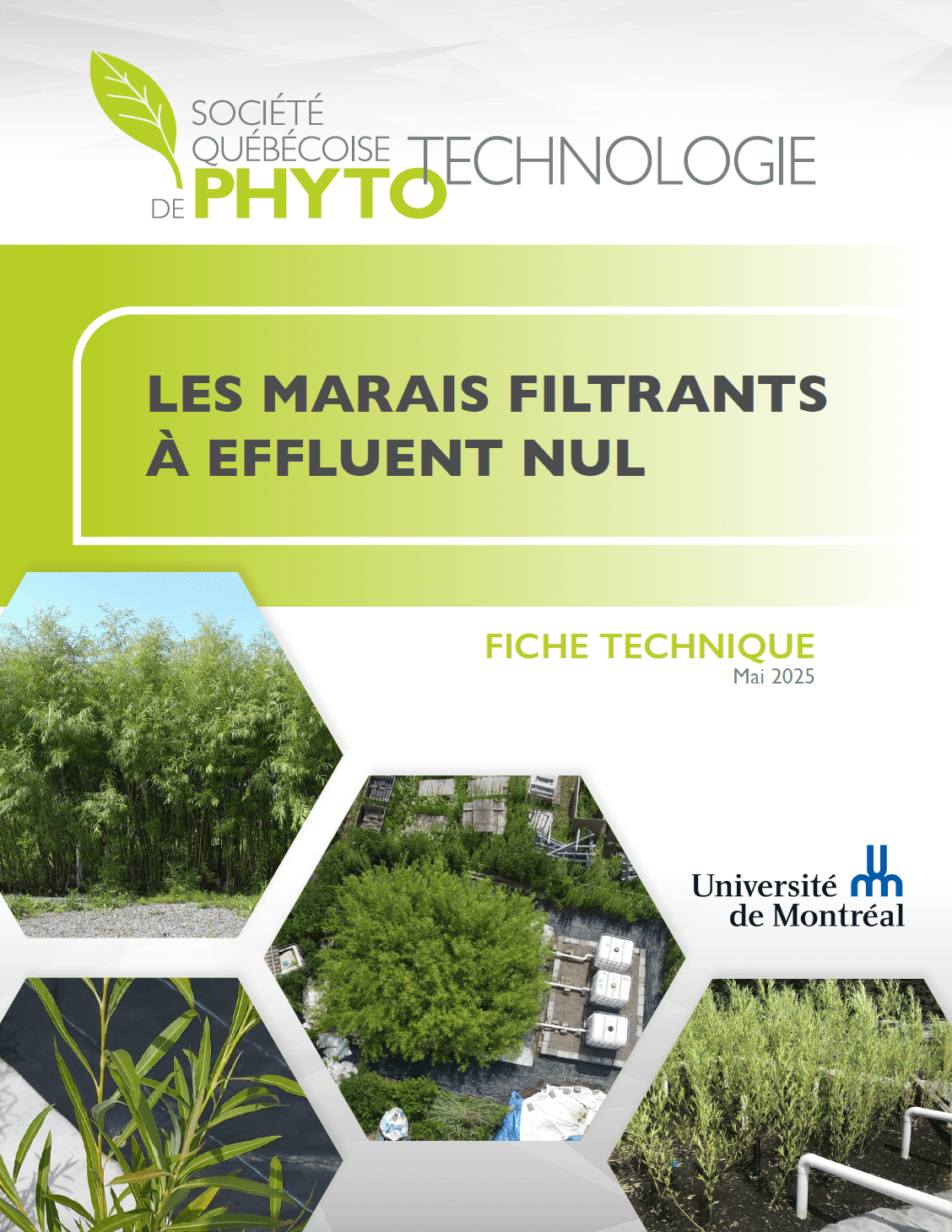
Les marais à effluent nul (2025)
Résumé : Les végétaux sont de formidables pompes à eau naturelles, fonctionnant grâce à l’énergie solaire. Les marais filtrants à effluent nul tirent parti de cette remarquable capacité des plantes pour éliminer complètement les rejets d’eaux usées, réduisant à néant la pollution hydrique associée. Les végétaux offrent donc une solution écologique efficace permettant de respecter les normes de rejet les plus strictes.Visionner la capsule vidéo sur les marais à effluent nul ici.

L’entretien des phytotechnologies (2024)
Résumé : La préparation des sols, l’irrigation, la taille, la lutte contre les maladies et les ravageurs ou encore le contrôle des adventices et des végétaux exotiques envahissants sont autant d’exemples d’entretien qu’il est nécessaire de pouvoir pérenniser pour garantir l’efficacité des phytotechnologies dans le temps. En outre, ce ne sont pas seulement les végétaux dont il faut assurer le maintien, mais l’ensemble des composantes de ces infrastructures.Auteurs : Laurianne Bédard et Jacques Brisson
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
Experts et réviseurs : Olivier Boucher-Carrier et Patrick Benoist
Auteurs : Maha Boushabi, Louise Hénault‑Ethier, Olivier Boucher-Carrier, Patrick Benoist, Maxime Fortin Faubert, Maxime Tisserant, Lise Gobeille et Sophie Duchesne

Les murs végétalisés (2022)
Résumé : Le but de cette fiche est de décrire les différents types de murs végétalisés, d’en résumer les principales fonctions et de faire ressortir dans quelles conditions l’installation maximise son rôle phytotechnologique.Cette phytotechnologique a comme objectifs principaux de fournir des services environnementaux, mais aussi économiques en réduisant les coûts de climatisation d’un bâtiment et en limitant certaines interventions sur les infrastructures grises.Auteurs : Jessica Champagne-Caron, Louise Hénault‑Éthier et Guillaume Grégoire

La stabilisation des pentes (2018)
Résumé : La stabilisation phytotechnologique des pentes consiste à utiliser les végétaux, seuls ou en combinaison avec des composantes statiques organiques ou minérales, pour maintenir en place les horizons de sol superficiels sur des pentes susceptibles à l’érosion. C’est principalement par le biais de leurs racines, qui agiront comme des ancrages, que les végétaux auront un effet positif sur la stabilisation du sol. Le recouvrement végétal du sol vient aussi ajouter à la stabilisation en limitant l’érosion hydrique et éolienne.Auteurs : Dominic Desjardins et les membres du c.a. 2017-2018 de la SQP.
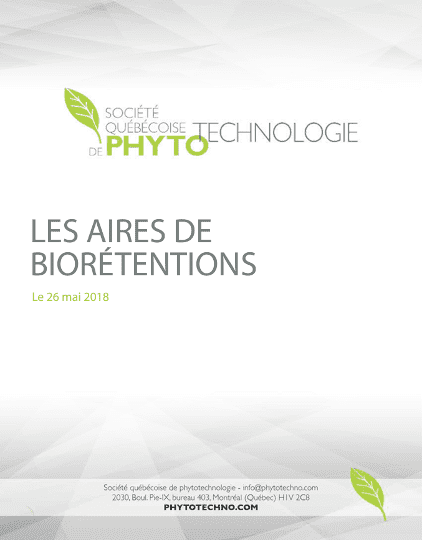
Les biorétentions (2017)
Résumé : Un jardin de pluie (aussi appelé jardin pluvial ou rain garden) est une forme de jardin d'eau permettant la gestion écologique du ruissellement urbain, en maximisant l’infiltration et l’épuration, contrecarrant ainsi certains problèmes découlant de la surabondance des surfaces imperméabilisées en ville. Alimenté uniquement avec de l'eau de pluie, sa conception doit permettre l'accumulation et la retenue d'eau par endroits ou faciliter l'infiltration lors des événements de précipitation intenses.Auteurs : Iseult Séguin Aubé, Raphaël Leblond, Éric Prido, Danielle Dagenais et les membres du c.a. 2016-2017 de la SQP.
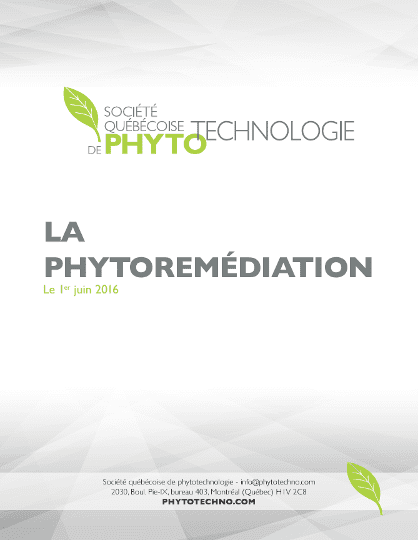
La phytoremédiation (2016)
Résumé : Simplement dit, la phytoremédiation c’est l’utilisation des plantes et des microorganismes qui leurs sont associés pour nettoyer l’environnement. C’est donc un ensemble de techniques in situ (pouvant être implantées directement sur le site contaminé) misant sur les plantes pour extraire, dégrader ou immobiliser les contaminants dans les sols, les sédiments, les boues ainsi que dans l’eau de surface ou souterraine et dans l’air. La phytoremédiation est aussi décrite comme une stratégie économique et efficace d’éco-remédiation fonctionnant à l’énergie solaire.Auteur : Louise-Hénault-Ethier et les membres du c.a. 2015-2016 de la SQP

Les toits végétalisés (2015)
Résumé : Les toits végétalisés (green roofs, living roofs ou ecoroof en anglais) sont des toitures entièrement ou partiellement recouvertes de végétation qui forment des milieux biotiques. Il s’agit d’une technique relativement simple qui peut s’implanter à de multiples endroits et qui rend de nombreux services écologiques, au béné ce de l’environnement et des communautés.Auteurs : Élise Gaudry, Sarah Lacombe, Isabelle Dupras, Lise Gobeille, Michel Rousseau et Claude Vallée ainsi que les membres du c.a. 2013- 2014 et 2014-2015 de la SQP.
Les lits de séchage (2014)
Résumé : Les lits de séchage plantés de macrophytes (LSPM) ont pour objectif de minéraliser et réduire le volume des boues afin de faciliter leur transport, leur valorisation et leur disposition. Les LSPM sont une déclinaison des marais filtrants à écoulement vertical sous-surfacique utilisés pour le traitement des eaux usées domestiques. À l’instar de ces derniers, ils se composent d’un massif filtrant planté de macrophytes aquatiques reconstituant ainsi un écosystème responsable du traitement des boues produites par les procédés de traitement biologique des eaux usées.Auteurs : Julie Vincent, Jacques Brisson et les membres du c.a. 2013-2014 de la SQP.